
TPE
Le Fonctionnement de l'audition: de l'oreille au cerveau

Comment le son venant de l’extérieur arrive t-il jusqu’à notre cerveau ?
L'Oreille
Au nombre de deux chez l'homme, les oreilles se situent de chaque côté de notre tête. Elles ont deux fonctions : permettre l'équilibre et l'audition. L'oreille se divise en trois parties : l'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne.
Lorsque quelqu'un parle, chante ou met de la musique, des vibrations sont émises, ce sont des ondes sonores.
Nous allons suivre le parcours de ces ondes de l'oreille au cerveau afin de mieux comprendre cette anatomie.
A savoir :
Le son est une variation de pression qui peut être rapide ou lente. Les variations lentes produisent des sons graves et les variations rapides produisent des sons aigus.
L'oreille
externe
Les ondes sonores émisent, arrivent jusqu'à nos oreilles et plus précisément jusqu'au pavillon.
Le pavillon correspond à la partie visible de notre appareil auditif, il est constitué de cartilage et de nombreux replis, qui lui permettent de mieux capter les vibrations sonores.
Ces ondes entrent ensuite dans le canal auditif externe, c'est un espace rempli d’air qui a un rôle de résonateur et d'amplificateur. Puis elles arrivent jusqu’au tympan. Le tympan est une membrane élastique, mince mais résistante. Elle permet la transmission des sons arrivant du conduit auditif à la chaîne d’osselets de l’oreille moyenne. Elle constitue la limite entre l’oreille externe et l’oreille moyenne.
Ainsi le rôle de l'oreille externe est de capter, d'amplifier et de transmettre le son à l'oreille interne

L'oreille
moyenne

Poursuivons le parcours des ondes dans l'oreille moyenne:
Lors du passage des ondes sonores, le tympan commence à vibrer et transforme ainsi l’énergie acoustique en énergie mécanique. Le tympan est relié aux trois plus petits os de notre corps: le marteau, l’enclume et l’étrier. Ces os forment ensemble la chaîne des osselets. Grâce à un jeu de vibration, ils permettent d'amplifier le son d'environ vingt fois et de le transmettre jusqu’à la petite fenêtre ovale de l’oreille interne, à la-quel l'étrier est relié.
En arrivant dans l'oreille interne, les vibrations passent d'un milieu aérien (celui de l'oreille moyenne) à un milieu liquide (celui de l'oreille interne). Si elles n’étaient pas auparavant amplifiées par les osselets, la transmission de l’énergie acoustique se ferait avec une perte d'environ trente décibels.
Ainsi le rôle de l’oreille moyenne est de transmettre les vibrations à l’oreille interne sans perte d’énergie.
L'oreille moyenne est aussi constituée de la trompe d'Eustache qui assure l’équilibre de pression entre l’oreille moyenne et l’extérieur, afin d'éviter une rupture du tympan, due à une trop grande différence de pression.
L'oreille
interne
L'oreille interne est composée de deux nerfs (le nerf vestibulaire et le nerf cochléaire (dit auditif)) et de deux organes : la cochlée et le vestibule. Le vestibule est l'organe de l'équilibre, il renseigne sur la position du corps et de ses mouvements. La cochlée quant à elle, est l'organe de l'audition. Nous n’étudierons pas plus précisément le vestibule car seulement la cochlée intervient dans l'audition.
La cochlée (autrefois appelée limaçon, du fait de sa ressemblance à une coquille d'escargot), est une cavité dans l'os remplie de fluide. Elle a la forme d’un tube osseux, de 3 cm environ, enroulé sur lui-même sur deux tours autour d’un axe d’où part le nerf cochléaire. La cochlée est un tube divisé en trois canaux : La rampe vestibulaire, la rampe tympanique et entre les deux, le canal cochléaire (composé de l'organe de Corti).
La rampe tympanique débouche sur la fenêtre ronde et la rampe vestibulaire sur le vestibule (donc sur la fenêtre ovale). Représentant la partie auditive de l’oreille interne, la cochlée joue un rôle crucial. En effet elle permet de convertir l'énergie mécanique (vibrations) en signaux électriques complexes qui sont ensuite transmis au cerveau.

La cochlée

On distingue deux entités différentes dans l’oreille interne :
- le labyrinthe osseux : composé de la rampe vestibulaire et de la rampe tympanique.
- le labyrinthe membraneux: composé du canal cochléaire.
Lorsque qu’on parle de l’oreille interne, on parle de milieu liquide. En effet le labyrinthe osseux est noyé dans un liquide (ou fluide) nommé périlymphe et le labyrinthe membraneux contient un autre liquide nommé endolymphe.
L'organe de Corti est un tout petit organe situé dans le canal cochléaire. Il repose sur la membrane basilaire (elle sépare la rampe tympanique et le canal cochléaire). Il est composé de cellules sensorielles : les cellules ciliées externes (environ 30 000, répartis sur trois rangées) et internes (environ 4000, sur une rangée). Ces cellules ont une spécificité : elle sont dotées de longs prolongements à leur surface appelés les stéréocils. Ils jouent un rôle de détection et d’amplification du son.
Ces cellules sont aussi présentes à plusieurs endroits le long de la cochlée. Celles situées à la base de la cochlée codent les fréquences aigues tandis que celles au centre (au centre du limaçon) codent les fréquences graves. Cela permet ainsi de pouvoir détecter la totalité des sons.
Le fonctionnement de l'organe de Corti repose sur la friction des cellules ciliées contre la membrane tectoriale (voir explication prochain paragraphe).
Ainsi lorsqu'une vibration entre dans la cochlée, elle est traduite en signaux nerveux par l'organe de Corti.
Les vibrations se propagent dans la périlymphe qui se met alors en mouvement. Cela engendre une pression sur la membrane basilaire qui commence à onduler de bas en haut. Ces mouvements provoquent l'inclinaison des cellules ciliées et donc la mise en mouvement des stéréociles.

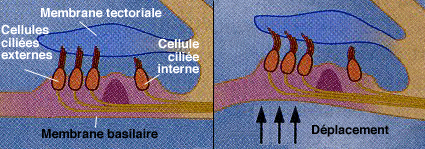
Les stéréocils des Cellules ciliées externes (CCE) sont les premiers stimulés. Ils jouent un rôle de détection et d’amplification du son. Ils sont mit en mouvement d’abord par la vibration et vont ensuite eux-mêmes se mettre à vibrer, tout en envoyant un premier message nerveux au cerveau. Ce message permet d'avertir de la détection d’un son. La vibration des stéréocils des CCE va les mettre en contact avec la membrane tectoriale ainsi que les stéréocils des Cellules ciliées internes (ce sont les deuxième stimulées) . Un deuxième message nerveux beaucoup plus précis est alors envoyé.
Ces messages nerveux sont envoyés au cerveau, sous forme de décharges électriques, grâce au nerf auditif (ou nerf cochléaire).
Les 4 000 cellules sensorielles internes et les 30 000 cellules externes, sont reliées à 50 000 fibres nerveuses, cet ensemble représente le nerf auditif. Il est composé de millions de neurones qui se succèdent afin d'apporter les messages nerveux au cerveau.
Le Cerveau
Avant de poursuivre le parcours du message nerveux vers le cerveau, il est important de connaitre les bases de son fonctionnement.
Notre cerveau est une structure complexe, constituée d'environ 100 milliards de cellules nerveuses et pesant seulement 1 500 grammes. Pour pouvoir envoyer et recevoir des signaux, le cerveau a besoin de voies de communication : le système nerveux.
Le système nerveux est constitué de plusieurs milliards de cellules nerveuses se sont les neurones. Il constitue un véritable réseau de nerfs qui s'étend depuis les orteils jusqu'à l'extrémité des doigts en passant par le Tronc Cérébral. Ainsi le cerveau représente le centre de commande des activités de notre corps.

Le système nerveux

Le cerveau est formé de deux hémisphères:
- l'hémisphère droit, qui fonctionne de manière plus imaginative, intuitive, émotionnelle et déconnecté du temps. Il est le siège de la créativité.
- l'hémisphère gauche, qui est responsable de tout ce qui concerne la réflexion, la logique, l'analyse de l'abstrait, du temps, de la réalité mais aussi du langage. Lors du traitement du langage, c'est à dire lorsque nous parlons ou écoutons parler quelqu'un, deux zones du cortex cérébral sont principalement concernées. Il s'agit de l'aire de Broca et de l'aire de Wernicke.
L'aire de Broca est active lorsque nous parlons. Elle est responsable de la formation des mots ainsi que de la structure de base du langage qui est la grammaire. La détermination du débit de parole ainsi que la motricité du langage (c'est à dire le contrôle des muscles de la bouche, de la mâchoire ainsi que la formation des sons et la prononciation) font également partie des attributions de l'aire de Broca.
L'aire de Wernicke, quant-à-elle, est active lorsque nous entendons parler et essayons de comprendre ce qui est dit. Dans cette zone sont analysés la logique et le contexte de la phrase prononcée par son interlocuteur. Elle est active, par exemple, lorsque nous écoutons un exposé ou encore lors d'un match de football.
Ces deux aires fonctionnent de manière coordonnée grâce à une "autoroute nerveuse" qui assure un échange très rapide entre les deux aires. Cela permet de trouver les mots justes, les bonnes questions au bon moment ainsi que les réponses correspondantes.
Ces deux aires fonctionnent donc pour le langage oral mais pas que. En effet, nous avons découvert que chez une personne sourde l'aire de Broca et de Wernicke étaient aussi utilisées pour le langage signé avec la langue des signes.
Le cerveau est composé de trois parties :
- le Tronc Cérébral qui contrôle des fonctions automatiques de l'organisme telles que la respiration, la circulation du sang, les battements du cœur.
- le Cervelet qui contrôle la coordination et l'équilibre.
- le Cortex, dont sa surface est sillonnée de replis qui forment des zones ayant chacune leur propre fonction (sentir, parler, écrire, agir, se souvenir).
Le Cortex est composé de trois grandes types de zones :
- Les aires sensorielles, composées des zones des 5 sens. Elles contiennent entre autre le cortex auditif. C'est la partie du cerveau qui analyse les informations auditives, en effet les sons provenant des oreilles y sont décryptés et analysés.
- Les aires motrices et d'association, qui contiennent les aires de Broca et de Wernicke, développées précédemment.

Revenons- en au passage du message nerveux, détecté par les oreilles, vers le cerveau
Les messages nerveux, envoyés au cerveau via le nerf auditif, passent par différentes voies et différents relais avant d'arriver au cortex auditif (dans le cerveau) :

La voie primaire:
- Le message amené par le nerf auditif arrive dans le premier relais : les noyaux cochléaires (situés dans le tronc cérébral). Dans cette zone est effectué un premier travail important de décodage du message: la durée, l’intensité et la fréquence sont analysées.
- Le deuxième relais est le complexe olivaire supérieur. A ce niveau, les neurones porteurs du message électrique vont le transmettre à d'autres neurones qui vont à leur tour faire la suite du chemin jusqu'au relais suivant.
- Le message est ensuite véhiculé jusqu'au Colliculus Inférieur où le son est localisé.
- le quatrième relais est dans le thalamus. Ici est préparée, une réponse vocale (travail d'intégration)
- Enfin, le message arrive dans le cortex auditif. Il a déjà été en grande partie décodé durant son trajet ainsi il peut être reconnu, mémorisé ou intégré dans une réponse volontaire.
L'influx nerveux correspond à toute l'activité électrique qui existe dans le système nerveux. Il permet à un être vivant de contrôler ses gestes, de comprendre une information et de communiquer. L'influx nerveux émanant des cellules ciliées va gagner petit à petit le cortex auditif et permettre ainsi une analyse complète du signal sonore.
Il faut moins de 20 millisecondes pour que les ondes sonores soient transmises au cerveau.
La voie secondaire :
Le rôle de cette voie est de sélectionner les informations qui doivent être traitées en priorité. Elle est reliée aux centres de la vie végétative (cela correspond à toutes les fonctions vitales comme la respiration, la digestion ou encore la circulation sanguine), à l'éveil et aux émotions/motivations. Cette voie est plus longue que la précédente.
- Le premier relais de ce chemin est commun à la voie primaire, ce sont les noyaux cochléaires.
- Le message nerveux réalise plusieurs relais dans la formation réticulée. C'est ici que l'information est triée pour savoir si elle est prioritaire (elle prendra le chemin vert) ou non (chemin rouge, qui correspond à la voie primaire).
- Il aboutit au cortex polysensoriel en passant par le thalamus non spécifique.

Le cerveau d'un sourd est-il différent de celui d'un entendant ?
Des chercheurs de l’Université de l’Ontario ont découvert que lorsqu'une personne est sourde, son cerveau va automatiquement chercher à compenser ce sens perdu. C’est ce qu’on appelle la ”plasticité du cerveau”. La partie du cerveau qui traite normalement les sons est réorganisée et traite alors la vue. La vision est donc améliorée.
On peut donc en conclure que le cerveau d'un sourd et d'un entendant sont presque similaires. Ils diffèrent seulement au niveau de la vision. En effet une personne sourde, étant privée du sens de l'ouie, elle va voir sa vue se développer dans la zone qui est normalement réservée à l'audition. La vision d'un sourd va donc être améliorée, en partie au niveau de la vue périphérique.
Une étude a l'université de Sheffield, a montré que la vision périphérique des adultes nés sourds, est plus développée que celle d'un entendant. En effet les enfants sourds ont une vision périphérique aussi large que les enfants entendants. Mais lorsqu'ils grandissent, leur vision devient plus large que la normale. Il y a des changements importants au niveau de la vue lorsque l' enfant sourd grandit . Cette meilleure vue périphérique peut aussi être due à la pratique de la langue des signes qui demande un champ de vision plus grand.
Dans qu'elles langues pensent et rêvent les sourds et malentendants ?
Il faut savoir qu'entre 21 et 36 mois, le bébé acquiert les bases fondamentales du langage créant ainsi une nouvelle zone dans le cerveau: l'infrastructure cognitive. Cette infrastructure est essentielle à la communication. Le langage, le raisonnement, l'apprentissage, l'intelligence, la résolution de problèmes, la prise de décision, la perception ou l'attention font parties de la cognition, c'est donc l'ensemble des processus mentaux liés à la connaissance.
Il est préférable de détecter la surdité le plus tôt possible car si le diagnostic est trop tardif (souvent à la scolarisation), l'enfant aura de grosses difficultés d'apprentissage. Une surdité rapidement détectée permet à l'enfant d'acquérir plus facilement un langage gestuel comme par exemple la langue des signes (lsf).
De plus l’étude des rêves, effectuée par des IRM, a permis de montrer les régions cérébrales activées lors des rêves ainsi que la langue utilisée dans les rêves.
Ainsi, une personne née sourde, va penser dans la langue qu'elle utilise au quotidien, le plus souvent étant la langue des signes, si elle est intégrée tôt (cela va donc dépendre du moment ou le diagnostique a été fait).
Lors du sommeil, maîtrisant la lsf depuis son plus jeune âge, elle va codifier ses rêves en signes. Il arrive régulièrement, que les sourds gesticulent durant leur sommeil car il pense en lsf.
Une personne devenue sourde à un âge tardif pensera et rêvera, quant-à-elle dans la langue apprise durant son enfance.